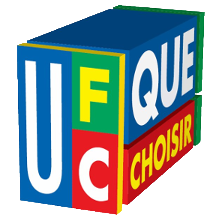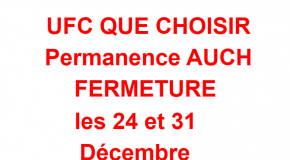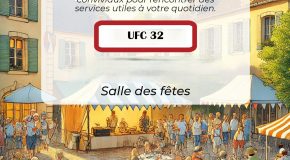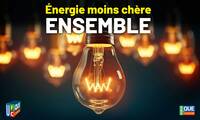L’électrique vaut-elle le coût ?
Essence (simple ou hybride) ou électrique ? Nos calculs pour savoir laquelle de ces motorisations est économiquement la plus intéressante à l’usage.
La voiture reste toujours centrale dans la mobilité des Français. Elle assure plus de 80 % des kilomètres parcourus et 83 % des ménages en possèdent au moins une. Ce qui change, c’est le type de motorisation disponible et l’éviction du gazole. Désormais, selon le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), en 2024, dans l’Hexagone, les véhicules à essence et hybrides ont représenté 72,3 % des ventes, et les électriques, 16,9 %.
Si l’on ne tient pas compte des primes à l’achat, l’auto électrique ne devient rentable qu’au bout de deux ans de possession pour une Volkswagen ID.3, cinq ans s’agissant d’une Peugeot e-208 et huit ans avec une Tesla Model Y. La première année, un véhicule électrique neuf revient toujours plus cher à son détenteur qu’une version équivalente essence : ainsi, il faudra dépenser 729 € de plus pour un petit modèle, 188 € pour un gabarit moyen et 1 080 € pour un de grand format.
La raison ? Le coût d’usage inférieur ne compense pas le prix d’achat élevé. Selon une enquête Ifop de janvier 2025 réalisée pour Roole, cela rebute 47 % des Français (57 % en zone rurale). Les aides sont donc déterminantes pour le succès de cette motorisation. Notre étude montre que les dépenses liées à l’utilisation d’une voiture électrique d’occasion, quelle que soit sa taille, sont inférieures à celles d’une thermique équivalente. Cela résulte de frais faibles et d’une dépréciation du véhicule surtout supportée par celui qui l’achète neuf. Ainsi, pour un modèle de dimension moyenne, le second propriétaire économisera annuellement 848 € (pendant cinq ans) et le troisième, 568 € (sur sept ans), soit un gain de respectivement 26,7 et 21 % par rapport à une essence équivalente.
La recharge à domicile prime
Après l’achat, le budget « carburant » est un poste où l’électricité se démarque. Avec la tarification actuelle, rouler en électrique s’avère meilleur marché qu’en essence, à condition de recharger chez soi (ou au travail), là où les électrons sont les plus abordables. Sans quoi, en utilisant exclusivement des bornes publiques beaucoup plus chères, le coût de possession (lire l’encadré ci-contre) s’élève à 544 € par an pour le premier acquéreur, à 376 € pour le second et à 253 € pour le troisième. Sur la base de cette étude, l’UFC-Que Choisir demande que des garanties soient données aux consommateurs concernant plusieurs points : l’accès à des coûts de recharge avantageux au domicile comme sur les bornes publiques ; un meilleur encadrement du secteur des bornes en matière d’information sur les prix et de structure tarifaire ; le maintien des aides à l’achat jusqu’à l’atteinte de la parité de coût entre voitures électriques et thermiques et leur recentrage sur les modèles électriques les moins émetteurs.
Comment nous avons procédé
Le coût total de possession (TCO) est calculé pour trois catégories de véhicules en version thermique et électrique : petits (Fiat 500, Peugeot 208/e-208) ; moyens (Volkswagen Golf/ID.3) et grands (Skoda Kodiaq/Tesla Model Y).
Ce TCO est établi pour un total de 190 000 km sur une durée de 16 ans décomposée en trois périodes (4, 5 et 7 ans) :
• Véhicule neuf parcourant 15 000 km/an, soit 60 000 km ;
• Seconde main âgée de cinq à neuf ans faisant 12 000 km/an, soit 60 000 km ;
• Troisième main de 10 à 16 ans roulant 10 000 km/an, soit 70 000 km.
À noter Les coûts d’acquisition et ceux, énergétiques, d’utilisation (dont l’installation d’un point de recharge à domicile) ont été pris en compte, mais pas ceux liés à la maintenance ou à l’assurance, ni les aides à l’achat.